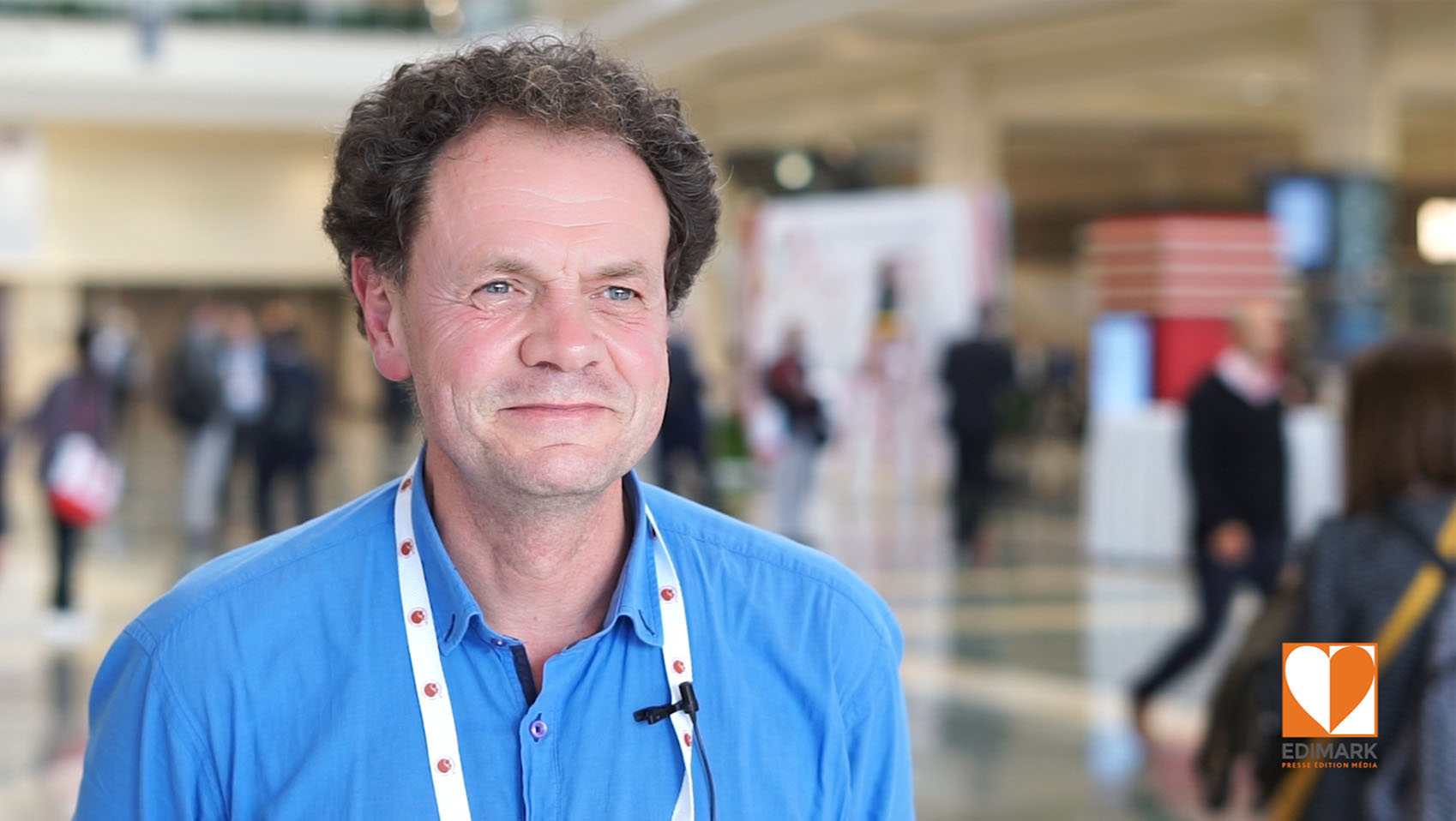PROGRAMME
Télécharger PDFComité scientifique : H. SBAI / S. REGRAGUI / M. AABDI / O. HARI
Comité organisationnel : A. LOUBARIS / R. OUIDANE / I. EL BOUTAHIRI / I. EL GHOUCH / L. AZAYM / A. MOHALLEM
Pré congrès
Journée de formation au profit des résidents/infirmiers
(108 Participants)
Ce masterclass est destiné aux infirmiers et résidents en hématologique clinique afin d'améliorer leur connaissance quant à la prise en charge des neutropénies fébriles / chocs septiques chez les patients atteints d'hémopathies malignes. Afin de diversifier l'approche pédagogique du sujet, les participants sont répartis en deux groupes échangeables, entre les scenarii de simulation et la chambre des erreurs, sur 2 sites séparés.


Modérateurs : R.BEN LAKHAL / S.CHERKAOUI


Évolution des découvertes sur le fonctionnement cérébral :
des premières localisations cérébrales à la stimulation cérébrale profonde

Séance éducationnelle
MRD dans la LAL : entre défis et challenges


Modérateurs : I.BEN AMOR / S.BENCHEKROUN
Thromboses et situations particulières


Modérateurs : I.BEN AMOR / S.FARES
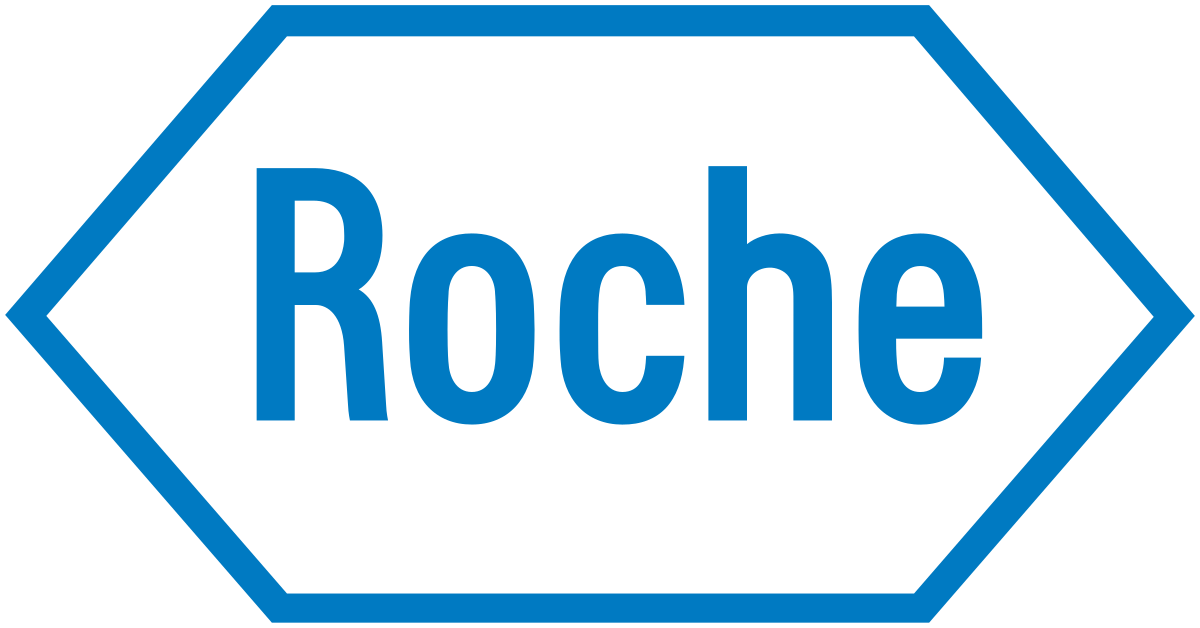
Apport de la pharmaco économie dans la prise en charge des patients hémophiles à l’ére de l’Emicizumab



Thrombopénies immunes


Séance éducationnelle
Leucémie myélomonocytaire chronique
Modérateurs : N.BEN ABDELJALIL / N.IDRISSI
est-ce faisable chez nous ?
the Spanish model of advanced therapies: ensuring patient access to CART cells
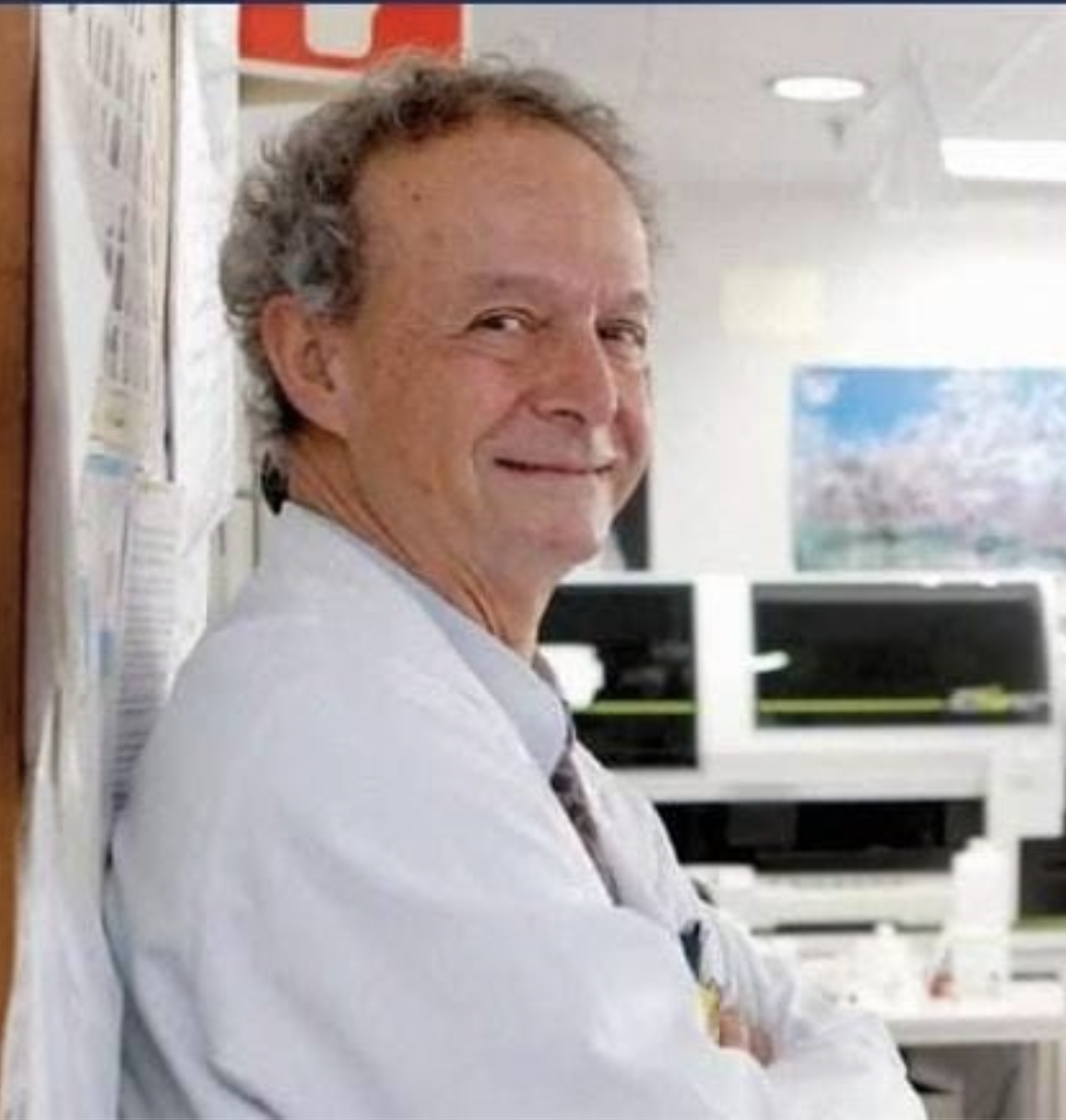

Modérateurs : D.JABER / A.QUESSAR


Transfusion et cytopénies immunes : quelles actualités en 2024 ?
Modérateurs : L.LOUKHMAS / T.BEN OTHMAN

Modérateurs : S.BOUKHRIS / O.EL GRAOUI

MDS en situations réelles



Modérateurs : I. FRIKHA / K.DOGHMI
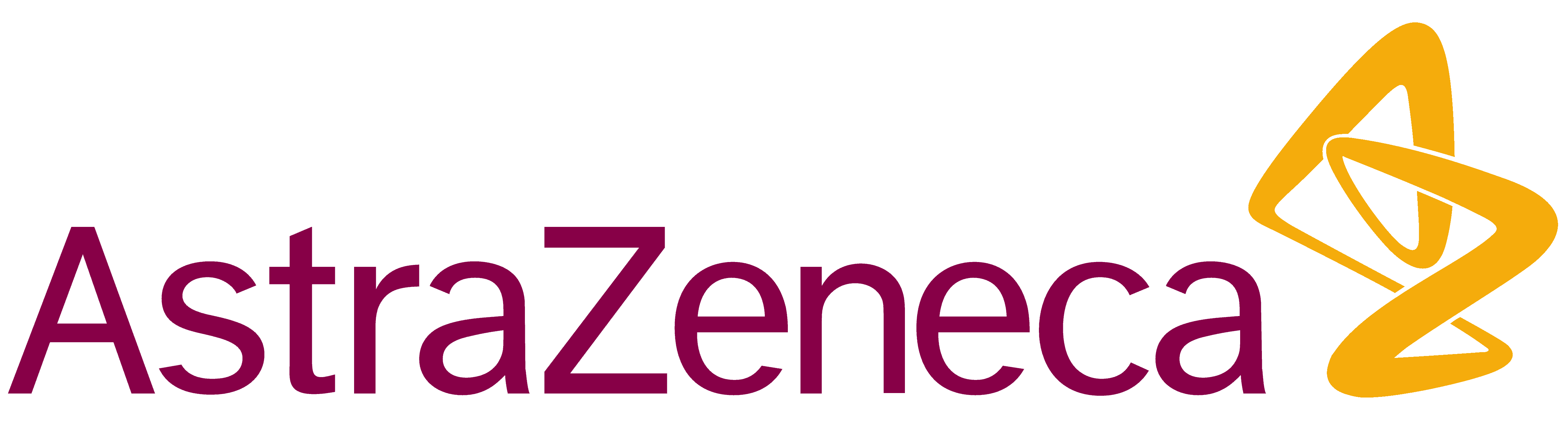
Place de l’Acalabrutinib dans le traitement de la LLC en 1ère ligne


Duré fixe de traitement dans la LLC: stratégies et impacts


Modérateurs : M.A LAATIRI / M.HARIF

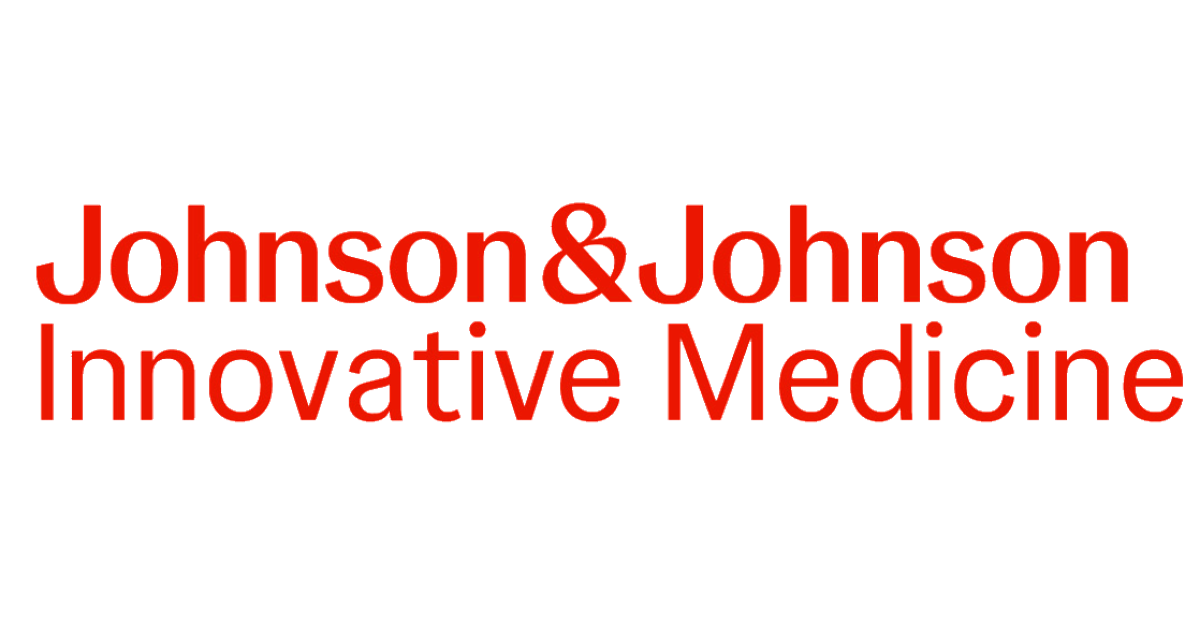
Modérateurs : T. BEN OTHMAN / S. REGRAGI



C1: Résultats thérapeutiques du lymphome de Hodgkin de l'adulte
Expérience Tunisienne
Malak S, Sayadi M, Miled W, Mansouri R, Ben Lakhal R, Dorra J, Karima K
SERVICE HEMATOLOGIE CLINIQUE HOPITAL AZIZA OTHMANA
Introduction :
La prise en charge des patients atteints d'un lymphome de Hodgkin (LH) a bénéficié ces dernières années d'importants progrès thérapeutiques, fondés sur l'immunothérapie, permettant de guérir 80 % des patients. L'objectif actuel est de diminuer l'exposition à des traitements toxiques chez les patients ayant une maladie chimio sensible.
Objectif :
L'objectif de notre étude est de décrire les caractéristiques épidémio-clinique, pronostique et de rapporter les résultats thérapeutiques de patients suivis pour LH.
Matériel et méthodes / patient :
Il s'agissait d'une étude rétrospective descriptive menée au centre d'hématologie clinique adulte à l'hôpital Aziza Othmana incluant les patients adultes atteints de LH entre janvier 2016 et décembre 2023. Ces patients ont été traités selon le protocole national tunisien MDH2015 et stratiïés en 5 groupes thérapeutiques en tenant compte de l'âge, le stade, le nombre de sites ganglionnaires, la VS, l'atteinte sous diaphragmatique, la masse tumorale et l'index-médiastino-thoracique.
Le traitement des groupes 1 et 2 était basé sur la chimiothérapie type ABVD+Radiothérapie des sites initialement atteints.
Le traitement du groupe 3 défavorable était à base des cures BEACOPP(R).
Le traitement des sujets âgés (groupes 4 et 5) dépend du performans status, du stade de la maladie et des comorbidités cardio-pulmonaires (AVD ou COPP).
Résultats et discussions :
Nous avons colligé 282 patients. L'âge médian était de 32,5 ans [15-88 ans] avec une prédominance féminine (sex-ratio à 0,85). Au diagnostic, on a noté la présence de symptômes B chez 59,3% des patients, un bulky chez 29,3%, un gros médiastin dans 21,7% des cas, une compression veineuse dans 20% des cas, une VS accélérée dans 63,4%. Selon la classification d'Ann Arbor, 58% des patients avaient un stade étendu (20,7 % stade III, 37,2% stade IV) et 42 % des patients avaient un stade localisé (4,8 % stade I, 37,2 % stade II).
Dans le bilan d'extension, le PET scanner a été réalisé chez 20 % des patients permettant un upstaging dans 40 % des cas. Quant à l'évaluation thérapeutique en fin de traitement, parmi les sujets évaluables :
Dans le groupe 1 (n=15), le taux de réponse globale était de 100 %. Aucune rechute n'a été notée.
Dans le groupe 2 (n=83/84), le taux de réponse globale était de 96 %. Trois cas de rechute ont été notés. La SG et la SSE étaient respectivement de 98% et 83% à 30 mois.
Dans le groupe 3 (n=137), le taux de réponse globale était de 86,7 %. Quatre pourcents des patients ont rechuté. La SG et la SSE à 30 mois étaient de 90% et 75%
Dans le groupe 4 (n=21/23), le taux de réponse globale en fin de traitement était de 88 %. Un cas de rechute a été noté.
Dans le groupe 5 (n=17/23), le taux de réponse globale en fin de traitement était de 64 %. Un cas de rechute a été noté.
La SG et la SSE à 30 mois des sujets âgés (G4 et G5) étaient de 80% et 73%. La mortalité de toute la série était de 7,3 % (16 décès maladie, 2 décès toxiques, 2 décédés par autre cause), Le taux de LH réfractaire était de 14% et le taux de rechute était de 10%. La SG ainsi que la SSE à 30 mois de notre série étaient respectivement de 92% et 78%.
Conclusion :
Notre série est caractérisée par une prédominance des stades étendus et une fréquence considérable des sujets avec forte masse tumorale. Le TEP scanner, indisponible en Tunisie entre 2016 et 2019, a permis une stratification du risque pour une prise en charge optimale. Les données des SG et SSE étaient comparables à la littérature. Une meilleure gestion des formes réfractaire reste un challenge dans notre pays.
C2 : Thrombopénie et grossesse : étude descriptive et prise en charge de la thrombopénie gestationnelle et du purpura thrombopénique idiopathique (PTI)
Mlayah Z, Ben Rekaya I, Mezhoud N, Slama N, Bizid I, Boufrikha W, Boukhris S, Laatiri M
CHU fattouma Bourguiba Monastir, service d´hematologie clinique de Monastir
Introduction :
La thrombopénie est le deuxième trouble hématologique le plus fréquent chez les femmes enceintes après l'anémie, elle touche environ 8 à 10 % des femmes enceintes et c´est une source notable de morbidité et de mortalité pendant la grossesse. La thrombopénie gestationnelle (TG) constitue environ 75 % des cas de thrombopénie survenant pendant la grossesse. On considère que la TG résulte d'une destruction accélérée des plaquettes, ainsi que d'une augmentation du volume plasmatique liée à la grossesse. Les complications de la grossesse telles que la prééclampsie et sa forme la plus sévère, le syndrome HELLP, représentent 20 % des cas de thrombopénie pendant la grossesse et le purpura thrombopénique idiopathique (PTI) 3 à 4 %. Dans 1 à 2% des cas, la thrombopénie peut résulter d'une coagulation intravasculaire disséminée, de maladies auto-immunes, congénitales, infectieuses et médicamenteuses ou encore d´hémopathies malignes.
Objectif :
Notre objectif est d'analyser les caractéristiques cliniques et les stratégies de prise en charge des patientes enceintes atteintes de GT ou de PTI.
Matériel et méthodes / patient :
Nous avons mené une étude descriptive rétrospective analysant plus de 72 cas de patientes enceintes prises en charge au service d'hématologie clinique du centre de maternité et de néonatalogie de Monastir, en Tunisie, de 2019 à 2023.
L'étude s'est concentrée sur la GT et la PTI. Les autres étiologies de thrombopénie pendant la grossesse ont été exclues.
Les patientes ont été classées comme ayant une GT si la femme avait au moins une numération plaquettaire enregistrée < 150000 à tout moment au cours des deuxième et troisième trimestres. Celles qui ont eu une thrombopénie au cours du premier trimestre ou avant la grossesse ont été classées comme ayant une PTI.
Les patientes ont été classées comme présentant des signes hémorragiques sévères si leur score de khellaf est > 8. Dans cette étude, nous avons utilisé SPSS pour analyser les résultats.
Résultats et discussions :
L'âge médian des patientes était de 29 ans. Environ 80 % des patientes avaient une GT et le reste avait un PTI chronique (évolution sur 12 mois). Près de 78 % des patientes n'avaient pas d'antécédents de thrombopénie gestationnelle (TG), tandis que 18,1 % en avaient un antécédent et 4,2 % en avaient trois. La majorité des patientes n'avaient aucun syndrome hémorragique avec un pourcentage de 87,5 %. Pour les patientes ayant connu des épisodes hémorragiques (12,5 %), 8,3 % avaient une GT et 4,2 % avaient un PTI.
Toutes les patientes avaient des saignements légers sans signes de gravité. La numération plaquettaire variait de 13 000 à 160 000/µL, avec une médiane de 91 464/µL. La distribution de la sévérité de la thrombopénie parmi les patientes était la suivante : modérée (50 000 - 100 000 plaquettes/µL) dans 52,8 % des cas, légère (> 100 000 plaquettes/µL) dans 40,3 % et sévère (< 50 000 plaquettes/µL) dans 6,9 % des cas.
Néanmoins, aucune corrélation statistiquement significative n'a été observée entre la numération plaquettaire et les manifestations hémorragiques. Toutes les patientes avaient une hémostase, des tests hépatiques et rénaux normaux. La numération plaquettaire a été normalisée après l'accouchement pour les patientes présumées atteintes de GT et ils n'ont pas eu besoin d'autres explorations.
Cependant, une évaluation étiologique a été demandée pour les patients atteintes de PTI. Tous les patientes PTI avaient des sérologies virales négatives (virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et virus des hépatites B et C), tandis que 4,2% d'entre elles avaient une sérologie HP (helicobacter pylori) positive et 18,1% avaient des tests immunologiques positifs (anticorps antinucléaires).
Concernant la prise en charge thérapeutique, pour les patientes avec une numération plaquettaire inférieure à 50 000 (environ 7%), nous avons opté pour un test thérapeutique aux corticoïdes et elles ont répondu à ce test, une seule patiente était corticorésistante et a eu besoin d'injections intraveineuses d'immunoglobulines avant l'accouchement alors qu'aucune n'a eu besoin de transfusion de plaquettes ou d'autres traitements. Notre prise en charge a assuré un accouchement sans événements hémorragiques pour nos patientes.
Conclusion :
Les grossesses compliquées de thrombopénies doivent être soigneusement évaluées en fonction de la gravité de la thrombopénie, de la période gestationnelle au moment du diagnostic initial et de l'étiologie. En particulier, le diagnostic différentiel entre GT et ITP est difficile en raison de l'absence de symptômes spécifiques. Par conséquent, une approche interdisciplinaire impliquant des hématologues et des gynécologues permet une prise en charge experte de ces patientes, réduisant ainsi leur risque de saignement pendant la grossesse et l'accouchement.
C3 : Rémission sans traitement au cours de la leucémie myéloïde chronique : Etat des lieux en Tunisie
Selma Kefi1, Rahma Mallek2, Yosra Ben Youssef3, Nader Slama4, Hela Ghedira5, Samia Mnif6, Emna Gouider7, Yosra Fakhfakh2, Moez Elloumi2, Adenene Laatiri4, Fehmi M'Sadek5, Raihane Ben Lakhal1
1-Service d'hématologie clinique, hôpital Aziza Othmana, Tunis
2-Service d'hématologie clinique, hôpital Hedi Chaker de Sfax
3-Service d'hématologie clinique, hôpital Farhat Hached de Sousse
4-Service d'hématologie clinique, hôpital Militaire Principal de Tunis
5-Service d'hématologie clinique, hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir
6-Laboratoire d'hématologie biologique, Institut Pasteur, Tunis
7-Laboratoire d'hématologie biologique, hôpital Aziza Othmana, Tunis
Introduction
Les inhibiteurs de la tyrosine kinase (ITK) ont révolutionné la prise en charge de la leucémie myéloïde chronique et après avoir atteint une espérance de vie normale sous traitement, l'enjeu actuel est Le maintien d'une rémission sans traitement (Treatment free remission : TFR).
Objectif
Rapporter l'expérience tunisienne sur l'arrêt des ITK.
Matériels et méthodes :
Il s'agit d'une étude rétrospective multicentrique, ayant inclus tous les patients suivis et traités pour une LMC dans 5 services d'hématologie clinique, répondant aux critères d'éligibilité à l'arrêt des ITK de l'ELN 2020 ou ELN 2013 (selon la période) et ayant pu arrêter le traitement.
Résultats
Parmi les 537 LMC diagnostiquées entre 2002 et octobre 2019, 157 patients étaient éligibles pour l'arrêt des ITK et seulement 65 patients (29H/ 36F) ont pu arrêter le traitement.
L'âge médian au diagnostic était de 45 ans [6-73]. Le score de Sokal était faible dans 36% des cas, intermédiaire (31%) et élevé (33%) des cas. Quatre-vingt-cinq pourcents des patients étaient sous imatinib pendant une durée médiane de 132 mois [60-219] et une durée médiane de réponse moléculaire 4Log (RM4) de 96 mois. Dix patients seulement étaient sous ITK2 reçus pendant une durée médiane de 108 mois.
Après un recul médian de l'arrêt des ITK de 49 mois [20-161], 14 patients (22%) ont présenté une rechute moléculaire dans un délai médian de 4 mois [1-52]. Tous les patients ont réatteint une réponse moléculaire profonde à la reprise du traitement.
Cinquante pourcents des patients ayant rechuté avait un haut risque de Sokal (p=0,17).
A noter que nous avons 9 patients non éligibles pour l'arrêt des ITK et qui ont dû arrêter leur traitement (désir de grossesse, toxicité), un seul patient parmi eux a présenté une rechute moléculaire 12 mois après l'arrêt et une réponse moléculaire profonde a été rapidement atteinte à la reprise du traitement.
Conclusion
L'arrêt de l'imatinib est faisable en Tunisie. Une étroite collaboration entre cliniciens et biologistes est indispensable pour programmer l'arrêt du traitement : un échéancier adapté en fonction de la capacité de chaque laboratoire et de la disponibilité des kits du suivi moléculaire.
C4 : Leucémie Myéloïde Chronique : Traitement par Imatinib générique chronic myeloid leukemia :
Treatment with generic imatinib
Maataoui-Belabbes Hajar, Qachouh Meryem, Berrada Sophia, Rachid Mohammed, Lamchahab Mouna, Benmoussa Amine, Khoubila Nisrine, Cherkaoui Siham, Madani Abdellah
Département d'hématologie et d'oncologie pédiatrique -hôpital 20 Août 1953-CHU IBN ROCHD CASABLANCA - MAROC
Résumé :
Introduction :
Le pronostic de la leucémie myéloïde chronique (LMC) a été révolutionné par l'avènement des inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK). L'imatinib permet une réponse cytogénétique complète de 91,8% et une survie globale avoisinant celle de la population générale. Imatinib générique a été également utilisé et permet des résultats thérapeutiques similaires.
Patients et méthodes :
Étude rétrospective réalisée au service d'hématologie du CHU Ibn Rochd Casablanca, du Janvier 2014 à Décembre 2023, incluant tous les patients LMC en phase chronique traités par Imatinib Générique.
Matériels et méthodes :
Il s'agit d'une étude rétrospective multicentrique, ayant inclus tous les patients suivis et traités pour une LMC dans 5 services d'hématologie clinique, répondant aux critères d'éligibilité à l'arrêt des ITK de l'ELN 2020 ou ELN 2013 (selon la période) et ayant pu arrêter le traitement.
Résultats :
Au total,172 patients ont été colligés, la médiane d'âge était de 45 ans avec un sexe-ratio F/H de 1.18. Le score de Sokal était élevé dans 46% des cas, intermédiaire dans 33% et bas dans 21% des cas. Le traitement par Imatinib Générique a permis une rémission hématologique complète à 3 mois chez 97% des patients et une rémission cytogénétique complète sur un recul moyen de 63 mois chez 66%. 28% des patients étaient réfractaires à l'imatinib, parmi lesquels 8 décès dont 6 par évolutivité de la maladie et 4 patients étaient perdus de vue en échec thérapeutique. Deux rechutes cytogénétiques étaient observées après un an et demi du traitement en moyenne. La réponse moléculaire était évaluée chez 95% des patients en rémission cytogénétique complète dont 73% (83) étaient en réponse moléculaire majeure (34%RMM3, 34%RMM4, 32%RMM5). L'évaluation de la rémission sans traitement (TFR) n'était pas réalisable dans notre contexte vu la difficulté du monitoring de la réponse. La survie globale et la survie sans événement à 10 ans étaient de 90,8% et 49,8% respectivement.
Conclusion :
Notre profil est caractérisé par un âge jeune des patients, la prédominance féminine et un score de Sokal élevé. Le défi majeur retrouvé était la non-observance intentionnelle ou non intentionnelle du traitement. Probablement l'utilisation d'un ITK de 2ème génération chez nos patients avec un score de Sokal élevé améliorait les résultats.
C5 : Stratégie De Désescalade Guidée Par Le Tep-Scanner Dans Le Traitement Des Stades Avancés Du Lymphome De Hodgkin : Etude Rétrospective Comparative Dans Un Centre Marocain
Apolinaire Afodome1, 2, El Mehdi Mahtat*1, 2, Othman Doghmi1, 2, Mounir Ababou1, 2, Selim Jennane1, 2, Hicham El Maaroufi1, 2, Kamal Doghmi1, 2
2Université Mohamed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc
Introduction :
Le traitement du lymphome de Hodgkin nécessite une balance délicate entre l'efficacité et la toxicité, soulignant l'importance des stratégies de désescalade pour les patients à des stades avancés de la maladie.
Objectifs :
Évaluer les résultats de la désescalade thérapeutique guidée par le TEP-scanner dans le lymphome de Hodgkin avancé dans une population marocaine, à travers une comparaison historique avec le protocole BEACOPP sans désescalade.
Méthodes :
Une étude rétrospective a été réalisée au Service d'Hématologie Clinique de l'HMIMV de Rabat, impliquant des patients adultes diagnostiqués d'un lymphome de Hodgkin classique aux stades III, IV et IIB défavorable, traités entre 2010 et 2023. Les patients pour lesquels la stratégie thérapeutique de désescalade a été décidée ont reçu 2 cycles de BEACOPP escaladé, suivis d'une désescalade à 4 cycles d'ABVD si le TEP2 était négatif, tandis que les patients TEP2 positifs ont reçu 4 cycles supplémentaires de BEACOPP escaladé. L'autre cohorte a reçu 6 à 8 cycles de BEACOPP sans désescalade. Les critères d'évaluation comprenaient la réponse au traitement, la tolérance, la survie globale (SG) et la survie sans progression (SSP).
Résultats :
Un total de 76 patients a été inclus, avec un âge médian de 31,5 ans et un ratio homme-femme de 2,16. Selon la classification d'Ann Arbor, 43 patients étaient au stade IV, 21 au stade III et 12 au stade IIB défavorable. Vingt patients ont été traités avec l'intention de désescalade. Cinquante-six patients ont reçu un traitement sans désescalade. Quinze d'entre eux (19,7 %) ont reçu 8 cycles de BEACOPP, qu'il s'agisse de 8 cycles escaladés ou de 4 cycles escaladés suivis de 4 cycles à doses standard. Les autres (80,3 %) ont reçu 6 cycles de BEACOPP. Le taux de rémission complète à la fin du traitement était de 90 % dans le groupe de désescalade et de 76,7 % dans le groupe sans désescalade. Avec un suivi médian de 17,3 mois pour le groupe de désescalade et de 79 mois pour le groupe sans désescalade, la médiane de la survie globale (SG) et de la survie sans progression (SSP) n'a pas été atteinte. Il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les deux régimes de traitement en termes de SG (p=0,677) et de SSP (p=0,623). La toxicité hématologique de grade 3 et 4 était plus marquée dans le groupe sans désescalade, avec des taux de 66 % contre 45 %.
Conclusion :
Notre étude rétrospective souligne la non-infériorité de la stratégie de désescalade dans le traitement du lymphome de Hodgkin au stade avancé. Cette stratégie devrait être la norme de soins pour les patients atteints de lymphome de Hodgkin au stade avancé en bonne condition physique, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, compte tenu de la disponibilité limitée des immunothérapies.
C6 : Thrombopénies immunes chez les sujets de moins de vingt ans : expérience du service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de l'hôpital 20 Août de Casablanca
Nizar Dahmaoui, Amine Benmoussa1, Fatima Zahra Loukal1, Siham Cherkaoui1, Mouna Lamchaheb1, Maryam Qachouh1, Mohamed Rachid1, Abdellah Madani1, Nisrine Khoubila1
1Service d'hématologie clinique, Centre hospitalier universitaire 20 Août Casablanca
RESUMÉ :
Nous avons réalisé une étude rétrospective intéressant 83 cas de thrombopénie immune (TI) chez des patients âgés de moins de 20 ans. A travers ce travail, nous visons à dresser un état des lieux sur les TI chez nos patients et également à apprécier son retentissement sur leur qualité de vie. Dans notre étude, l'âge médian était de 10 ans, avec prédominance féminine (71%) . Les motifs de consultation les plus fréquents étaient un syndrome hémorragique cutané (65%) ou cutanéo-muqueux (24%) de gravité modérée (jugée grade 3 de Buchanan) dans 54% des cas. Une thrombopénie initiale ≤ 20G/L a été retrouvée dans 77% des cas avec une valeur médiane de 8G/L. Le myélogramme a été demandé chez 51 patients. Les médicaments les plus prescrits restent les corticoïdes (87%), les IgIV étant utilisées d'emblée chez 5 patients. Le rituximab et l'Eltrombopag ont été utilisés chez 18 patients (22%) après échec des traitements de 1ère ligne. La splénectomie a été réalisée chez 11 patients avec bonne évolution dans 82% des cas. Une évolution chronique de la maladie a été notée chez 31% des patients. Le pronostic était globalement bon, le sexe masculin et un grade hémorragique 3 de Buchanan laissant présager des résultats plus favorables. L'étude de la qualité de vie chez 13 patients a permis de noter un score modéré à assez haut sur le plan global. Toutefois, lorsque les questions deviennent plus spécifiques, l'impact des TI s'accroît surtout pour les parents.
Le suivi de l’arrêt des antityrosines kinases dans le cadre de la Rémission Sans Traitement chez les patients suivis pour leucémie myéloïde chronique en réponse moléculaire profonde.
Y. Bouchakor Moussa ; S. Taoussi ; S. Oukid ; F. Lamraoui ; N. Rekab ; KM. Benlabiod ; H. Brahimi ; MT. Abad; M. Bradai.
Hématologie, EHS ELCC Blida; Université Blida 1, Algérie.
Prise en charge du Purpura Thrombopénique immunologique de l'adulte.
M. Bradai.
Hématologie, EHS ELCC Blida, Université Blida 1,Algérie.
Complications tardives du traitement de la maladie de Hodgkin
N.Ait Amer, F.Tensaout, N.Abdennebi, F.Belhadri, H.Moussaoui, F.Boukhamia, S.Akhrouf, I.Abderrahim, F.Louar, RM.Hamladji,R.Ahmed Nacer, M.Benakli.
Service Hématologie Greffe de Moelle Osseuse Centre Pierre et Marie Curie Alger, Algérie.
Nos partenaires
 Sponsor Platinum
Sponsor Platinum

 Sponsor Gold
Sponsor Gold
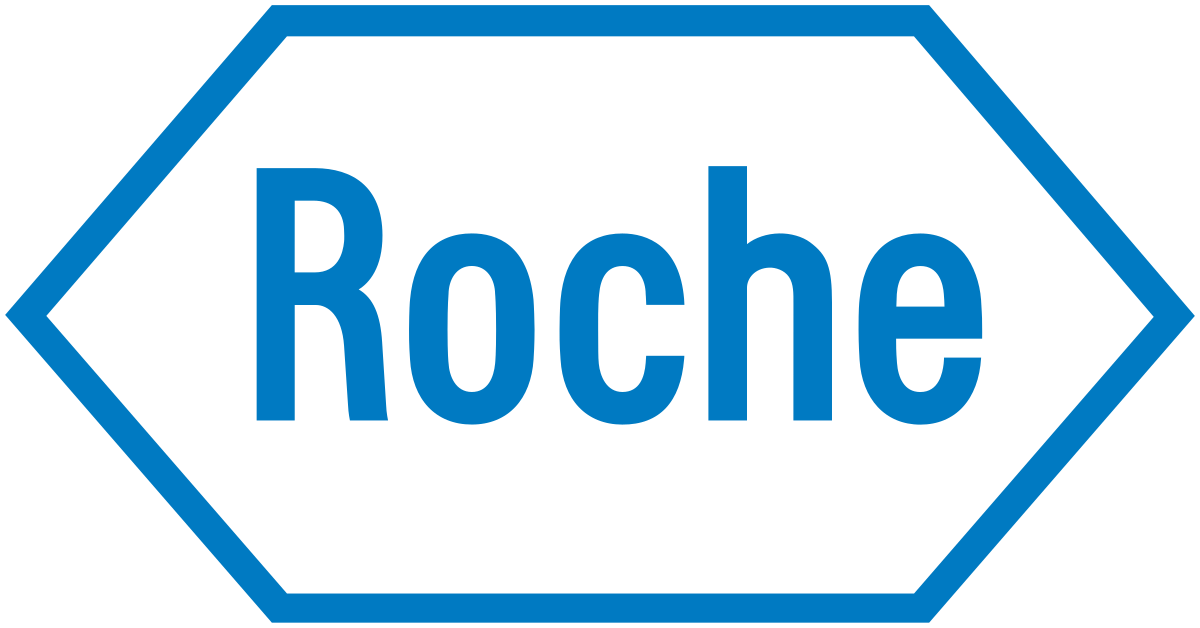

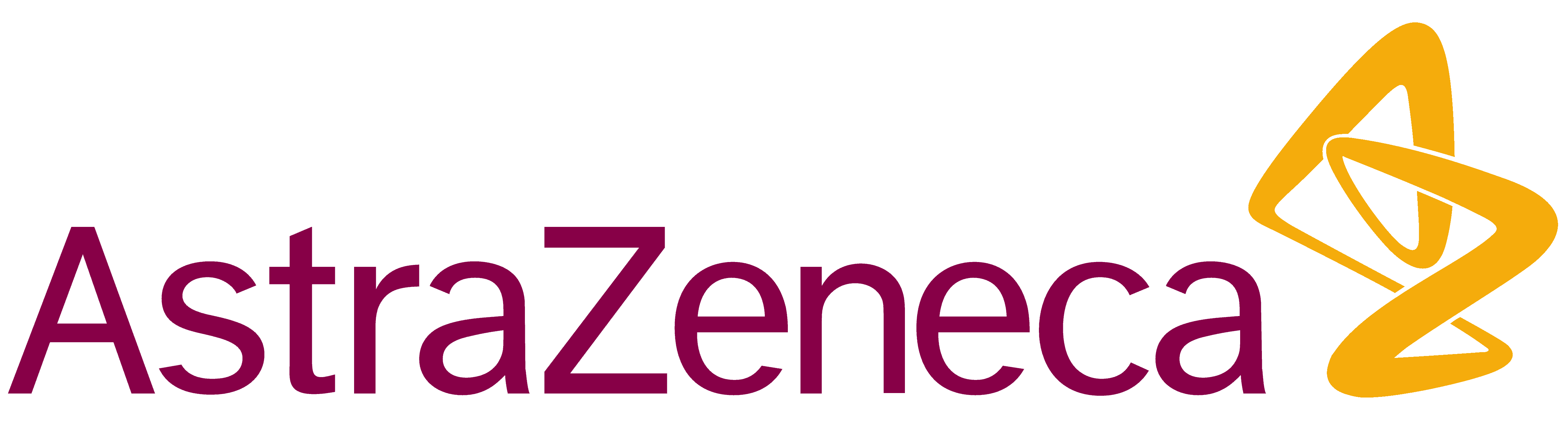


 Sponsor Silver
Sponsor Silver




 Sponsor Bronze
Sponsor Bronze